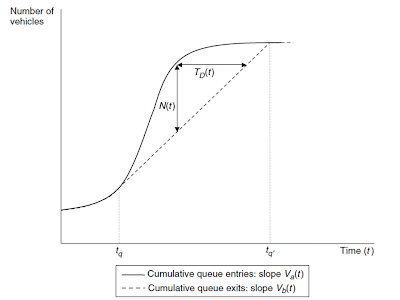Jacques Chirac a encore joué un bon tour à la classe politique en affirmant en plaisantant qu’il voterait François Hollande si Alain Juppé n’était pas candidat à droite.
Mon bon François (j'espère qu'il ne m'en voudra pas de cette familiarité, c'est un compliment sous ma plume), tout gêné devant cette soudain encombrante manifestation de sympathie et par cette affirmation devant les caméras, n’a eu de cesse d’affirmer depuis que c’était une plaisanterie, interprétation validée par l’ancien président qui a parlé depuis « d’humour corrézien » (sic).
Avec un vieux renard de la politique comme l’ex Président de la République, il n’est toutefois pas sûr que celui-ci n’ait pas eu une petite idée derrière la tête en manifestant ostensiblement les preuves potentielles de sa sympathie pour François Hollande.
Par exemple, je ne sais pas s’il est venu à l’idée de François, le candidat « normal », que le Grand Jacques pouvait avoir l’intention de voter pour lui aux primaires afin de minimiser les chances de victoire à la présidentielle d’un socialiste confronté au candidat qui sera désigné à droite, même si ce n’est pas Alain Juppé, son chouchou à lui. Lui est-il venu à l’idée que notre ex président puisse avoir l’esprit retors à ce point ? Ayant l’esprit tordu comme nombre d’économistes, je vais supposer que, peut être (c’est une pure hypothèse de travail !), nos grands politiques peuvent avoir une vision quelque peu machiavélique des élections quelle qu’elles soient. C'est là bien sûr un exercice de pure fiction.
Plus généralement, je suis surpris de l’absence de débat concernant le mode d’organisation de ces primaires socialistes et que personne ne voit que, telles qu’elles sont organisées dans leurs grands principes, les primaires socialistes me semblent très manipulables.
Quels en sont les grands principes ?
L'élection étant ouverte, tous les citoyens français inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre 2010 peuvent prétendre au vote. Les autres conditions nécessaires sont l'acquittement d'une participation aux frais d'organisation de 1 euro minimum, et la signature d'une charte d'adhésion aux valeurs de la gauche.
Pourront également déposer leur bulletin tous les mineurs qui auront 18 ans au moment de la présidentielle de 2012, ainsi que les mineurs et les étrangers non communautaires membres du Parti socialiste ou du Mouvement des jeunes socialistes.
Le mode de primaire est donc relativement ouvert, en tout cas ouvert aux non adhérents, l’euro versé au titre d’une participation aux frais d’organisation n’étant pas dissuasif pour les votants et le fait de signer une charte d’adhésion aux valeurs de la gauche me semble assez peu restrictif.
Pourront également déposer leur bulletin tous les mineurs qui auront 18 ans au moment de la présidentielle de 2012, ainsi que les mineurs et les étrangers non communautaires membres du Parti socialiste ou du Mouvement des jeunes socialistes.
Le mode de primaire est donc relativement ouvert, en tout cas ouvert aux non adhérents, l’euro versé au titre d’une participation aux frais d’organisation n’étant pas dissuasif pour les votants et le fait de signer une charte d’adhésion aux valeurs de la gauche me semble assez peu restrictif.
Il y des précédents célèbres à ce débat. En mars 1996, les citoyens californiens ont adopté à la majorité la proposition 198 (dite « blanket primary format ») qui consistait précisément à adopter un mode de vote aux primaires totalement ouvert, y compris aux non-membres des partis organisant chacun une primaire (républicains et démocrates of course !). Les opposants à cette proposition ont agi pour que l’élection présidentielle soit exclue du champ d’application de cette proposition, et à l’issue de divers revers légaux les déboutant, la Cour Suprême des Etats-Unis a déclaré que la proposition 198 était non-constitutionnelle en juin 2000.
Les opposants à ce mode d’organisation des primaires ont bien évidemment mis en avant l’aspect stratégique d’une ouverture complète du scrutin, les électeurs de l’autre bord votant stratégiquement afin d’éliminer le candidat du camp opposé qui serait le plus susceptible de l’emporter contre leur propre candidat. Un des juges de la Cour Suprême d’ailleurs déclaré, en se fondant sur la majorité des avis d’experts donné sur les effets de la proposition 198 :
« The prospect of having a party’s nominee determined by adherent of an opposing party is far from remote – indeed, it is a clear and present danger »
Pourtant, entretemps, les primaires pour la présidentielle américaine, se déroulaient, notamment pour les républicains, George W Bush étant opposé à John Mc Cain et avaient mis en évidence le danger de primaires ouvertes, avec un Mc Cain souvent victorieux dans les Etats avec primaire ouverte, et au contraire avec un Bush victorieux dans les Etats avec primaire fermée (en gros limitée aux seuls adhérents du parti républicain). Certains experts ont estimés que les votes croisés pouvaient représenter près de 25% des suffrages dans des Etats comme la Californie ou l’Etat de Washington, qui avaient adopté un mode de primaire totalement ouvert.
Mais il faut bien dire que l’évidence empirique qui permettrait de mettre en évidence un effet de manipulation en cas de primaires ouvertes reste relativement limitée, et surtout ne débouche pas sur un consensus, comme très souvent. Je ne vais pas développer ce point plus que cela, je laisse les éventuels politologues réagir à ce billet, puisque je vais évoquer une expérimentation de laboratoire dont l’objectif était précisément d’évaluer l’importance des votes croisés (ou des manipulations stratégiques de vote) en fonction du degré d’ouverture d’élections primaires.
L’article de Cherry & Kroll "Crashing the Party: An Experimental Investigation of Strategic Voting in Primary Elections", publié en 2003 dans Public Choice cherche donc à évaluer l’importance de ces manipulations dans le cadre d’une expérience de laboratoire. Pour ce faire, les auteurs examinent quatre possibilités de vote pour les primaires :
- Des primaires fermées : seuls les membres d’un parti, et ce depuis un minimum de temps, peuvent voter, et les indépendants (on affiliés à un parti) ne peuvent pas,
- Des primaires semi-fermées : les militants votent, ainsi que les indépendants qui déclarent une affiliation au parti juste pendant les élections primaires
- Des primaires ouvertes : le jour de l’élection primaire, chaque citoyen (militants, affiliés ou pas) choisit pour quel champ il vote et doit ensuite aller dans les bureaux de vote du parti pour lequel il s’est inscrit
- Des primaires totalement ouvertes (« blanket primary format » : le jour de l’élection primaire, chaque citoyen vote dans un seul bureau où toutes les candidatures primaires sont disponibles, et doit déposer un seul bulletin.
Lors de l’expérience, chaque élection veut reproduire la manière dont cela se passe dans la réalité, à savoir une première étape de primaire réalisée un jour donné, puis une seconde étape d’élections générales effectuée le jour suivant. Pour simplifier les issues, il y a deux candidats pour chaque primaire, et le candidat gagnant de chaque bord affronte l’autre.
Pour représenter l’orientation politique des candidats et des votants, un nombre compris entre 1 et 100 est tiré au sort pour chaque participant, les votants et les candidats obtenant un chiffre compris entre 1 et 45 appartenant au Parti A et les participants obtenant un chiffre compris entre 56 et 100 appartenant au parti C. Ceux qui obtiennent un chiffre compris entre 46 et 55 sont dans le parti B, et représentent en fait les indépendants (le centre en quelque sorte).
Dans chaque élection, il y a 23 votants, 9 dans le parti A, 9 dans le parti C et 5 dans le parti B, sauf pour les élections primaires fermées dans lesquelles les indépendants ne peuvent pas voter, et dans lesquelles il n’y a que 18 votants. Les positions des candidats aux primaires et aux élections générales sont connues de tous les participants (affichées par l’intermédiaire d’un écran d’ordinateur). Le gain d’un votant est d’autant plus fort que le candidat qui gagnera au final est proche du chiffre tiré au sort pour ce votant. Plus exactement il est égal à 100 moins la valeur absolue de la différence entre mon chiffre et le chiffre du candidat gagnant. En clair, si le chiffre d’un participant est 8, et que le candidat gagnant a un chiffre de 85, le participant gagne 100 – (85-8), soit 23 points. Le schéma de paiement est donc incitatif puisqu’il incite les participants à voter pour un candidat proche de leur position politique. Chaque participant vote à 24 reprises (il y a donc 24 élections pour chaque sujet) et ce uniquement pour un mode d’organisation possible des primaires (il y en a quatre).
Le vote stratégique - qui consiste à ne pas voter pour son candidat mais pour un autre - correspond à deux types de comportements, comme l’expliquent les auteurs. Il y a le vote stratégique positif d’une part et le vote stratégique négatif d’autre part. Le vote stratégique positif consiste à dire par exemple, si je suis un partisan de la gauche, me sentant proche d’un Arnaud Montebourg (après tout il est du Morvan comme moi et a grandi à l’orée des mêmes bois de sapin ou presque) mais à penser que, comme il n’a aucune chance lors de la présidentielle, il serait plus efficace de voter pour ce cher François (Hollande).
[Il est vrai que, statistiquement, les François ont été plus souvent à la tête de l’Etat français que les Arnaud, je laisse à Arthur le soin de compiler les statistiques avec R sur le long terme sur l'ensemble des pays de l'OCDE, quoique je ne suis pas très sûr de la significativité des données d'un point de vue statistique.]
Le vote stratégique négatif consiste, en supposant cette fois que je sois un électeur de droite, et que les primaires à gauche soient suffisamment ouvertes, à voter pour Arnaud Montebourg en pensant qu’il a toutes les chances de perdre face au candidat désigné par la droite. Cela pourrait concerner aussi les électeurs de droite en cas de primaire, qui pourraient voter pour un candidat de leur parti qu’ils jugent extrême (imaginons au hasard q’un certain Claude G. soit candidat aux primaires) car ils savent qu’il serait battu face au candidat plus modéré du camp adverse (je sais, c’est un peu pervers comme raisonnement, surtout un dimanche où notre intellect n’est plus tellement sollicité par les marathons télévisuels de Michel Drucker).
L’intérêt du design de l’expérimentation est qu’il permet d’identifier clairement les votes stratégiques de la part des participants.
Les résultats expérimentaux sont assez édifiants : la proportion de votes stratégiques dans le cas de primaires ouvertes ou totalement ouvertes est respectivement de 11% et 18% contre seulement 7% dans le cas de primaires fermées et 7.5% pour les primaires semi-fermées. Il est donc relativement net que le taux de manipulation stratégique du vote croit en raison du degré d’ouverture des primaires.
Mais le résultat le plus intéressant consiste à essayer de voir vers quel type de candidat gagnant à l’élection finale conduit chaque institution possible de primaire. Un des arguments en faveur d’un système de primaire ouverte est qu’il est susceptible de générer au final des candidats élus plus rassembleurs (voir ce qui est dit ici), donc par définition plus modérés, que dans le cas de systèmes de primaires fermés. Les résultats de Cherry & Kroll mettent en évidence l’absence de différence significative entre les différents systèmes possibles, le système semi-fermé semblant le plus apte à amener au pouvoir des candidats modérés, mais la différence avec les autres systèmes n’étant pas statistiquement significative. De ce point de vue, l’ouverture des primaires n’est pas une garantie de plus grande modération finale du gagnant.
Mais le résultat le plus intéressant consiste à essayer de voir vers quel type de candidat gagnant à l’élection finale conduit chaque institution possible de primaire. Un des arguments en faveur d’un système de primaire ouverte est qu’il est susceptible de générer au final des candidats élus plus rassembleurs (voir ce qui est dit ici), donc par définition plus modérés, que dans le cas de systèmes de primaires fermés. Les résultats de Cherry & Kroll mettent en évidence l’absence de différence significative entre les différents systèmes possibles, le système semi-fermé semblant le plus apte à amener au pouvoir des candidats modérés, mais la différence avec les autres systèmes n’étant pas statistiquement significative. De ce point de vue, l’ouverture des primaires n’est pas une garantie de plus grande modération finale du gagnant.
Un dernier point est le bien être général des citoyens. L’expérimentation de Cherry et Kroll mesure ce bien être simplement par la somme des distances des chiffres représentant la position de chaque votant au candidat finalement élu, et ce pour un mode de scrutin pour les primaires particulier. Le meilleur résultat est produit par le mode d’organisation des primaires semi-fermé suivi de près par des primaires totalement ouvertes, le pire étant les primaires totalement fermées, pas très loin des primaires dites « ouvertes ».
Comme il s’avère plus que probable qu’il n’y ait pas de primaire à droite, je pense qu’il est possible de dire que le système choisi par le PS s’apparente en fait aux primaires « ouvertes » telles que décrites ci-dessus. Pour ce système, les résultats de l’expérimentation à l’instant décrite montrent l’importance des votes stratégiques et un niveau de bien être pour les votants plutôt en retrait par rapport à d’autres institutions possibles de primaires. Par conséquent, je me demande vraiment si ce système est bon et pour le PS et pour la Nation…